Ils en raffolent mais la punissent : la mode est victime de l’hypocrisie patente des bien-pensants – et des penseurs tout court, d’ailleurs. Ceux-là la trouvent (au mieux) insignifiante et dénuée d’intérêt. D’ailleurs, on en parle pas, ou peu : il faut la bouder alors que partout elle se manifeste. Y compris dans leurs discours gourmés dont le ton est calculé, la posture aussi, le costume et la cravate soigneusement assortis. Mais la mode n’a pas dit son dernier mot. Si les grands du monde et les faiseurs d’idées l’ignorent, elle s’infiltre toujours quelque part entre leur posture et leurs chapeaux pour leur rappeler leur faiblesse : l’inévitable besoin d’être vu. Mais pourquoi serait-ce une faiblesse ? Il faut du courage pour s’habiller. La mode, inepte et idiote ? Elle a, au contraire, beaucoup à nous enseigner.
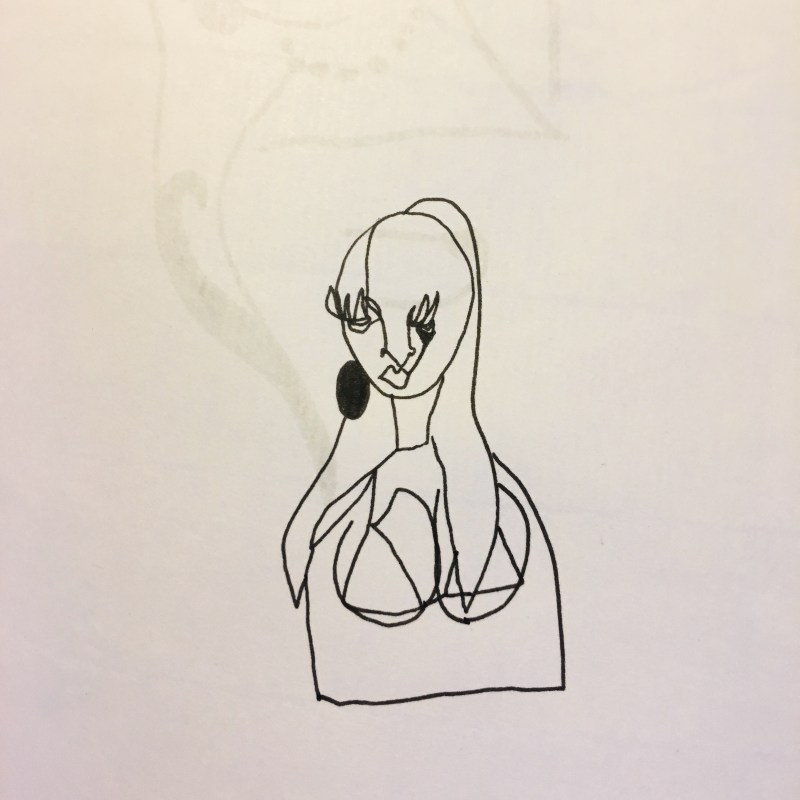
Premier problème : la mode ne s’adresse qu’aux corps. Elle ne s’adresse qu’aux femmes. Les femmes, chairs molles et lascives, sont les premières cibles de la mode, à laquelle s’oppose l’esprit. Substance vive et désincarnée, celle-ci échappe aux bassesses du corps pour s’élever vers les idées, les Formes platoniciennes dont notre héritage culturel demeure empêtré. Cette distinction philosophique entre le sensible et l’intelligible ne date pas d’hier et, jusqu’à peu, fut un motif de hiérarchisation des genres. La femme et son lait maternel est prédisposée aux affaires ménagères, pivot du foyer, là où l’homme, ferme puissance érectile, s’élève vers le savoir, affranchi des préoccupations charnelles et prêt à pénétrer le monde extérieur…
La femme est plus à même de vouloir s’intéresser à son propre corps : il est tout ce qu’elle a. Ou du moins a eu, pendant très longtemps. La mode est une arme grâce à laquelle elle a pu se démarquer, attirer l’attention, sortir du huis clos domestique. La manière dont le corps féminin est perçu et considéré détermine l’espace qu’elle va pouvoir occuper au-dehors. La mode lui sert d’atout. Il a fallu être belle, ou au moins audacieuse, car cela a été le seul moyen de briller. La mode a ainsi servi de substitut au statut professionnel et intellectuel, chasse gardée des hommes. Si la mode est une affaire de corporéité, c’est donc bien aux femmes qu’elle s’adresse.
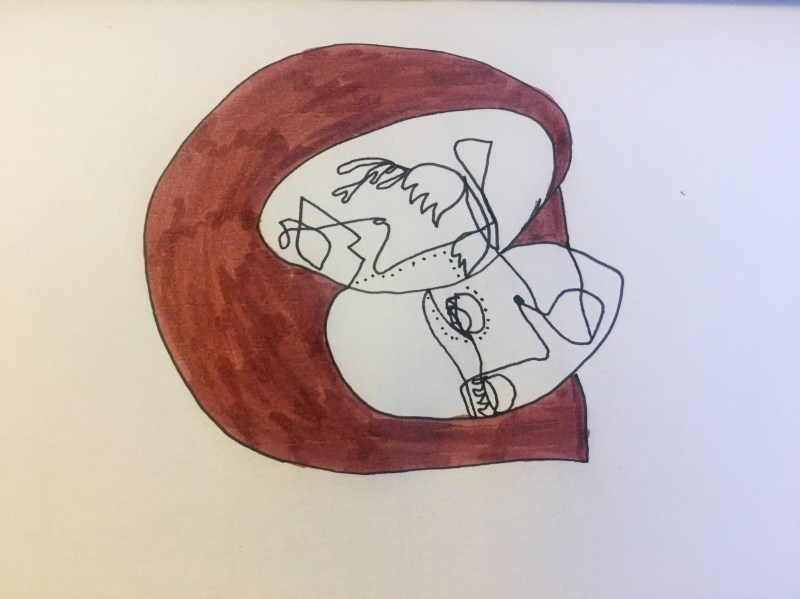
Les femmes vivent au travers d’une temporalité toute particulière, qui se calque sur le cycle de leurs corps. Les femmes, alertes depuis les premières menstrues, savent leur vie marquée par l’entrée et la sortie de la fécondité. Leur existence est toute entière articulée vers cette issue sans secours qui signifie, du même coup, la fin de la possibilité de la beauté. Le masculin au contraire vit la temporalité comme s’il était éternel; le féminin n’a que trop conscience de sa date limite, de la dégénérescence vers laquelle toutes sont conduites. Pour retarder l’obsolescence, il faut chamarrer la chair de mille ablutions et ainsi tromper le temps. La mode est aussi une stratégie de survie.
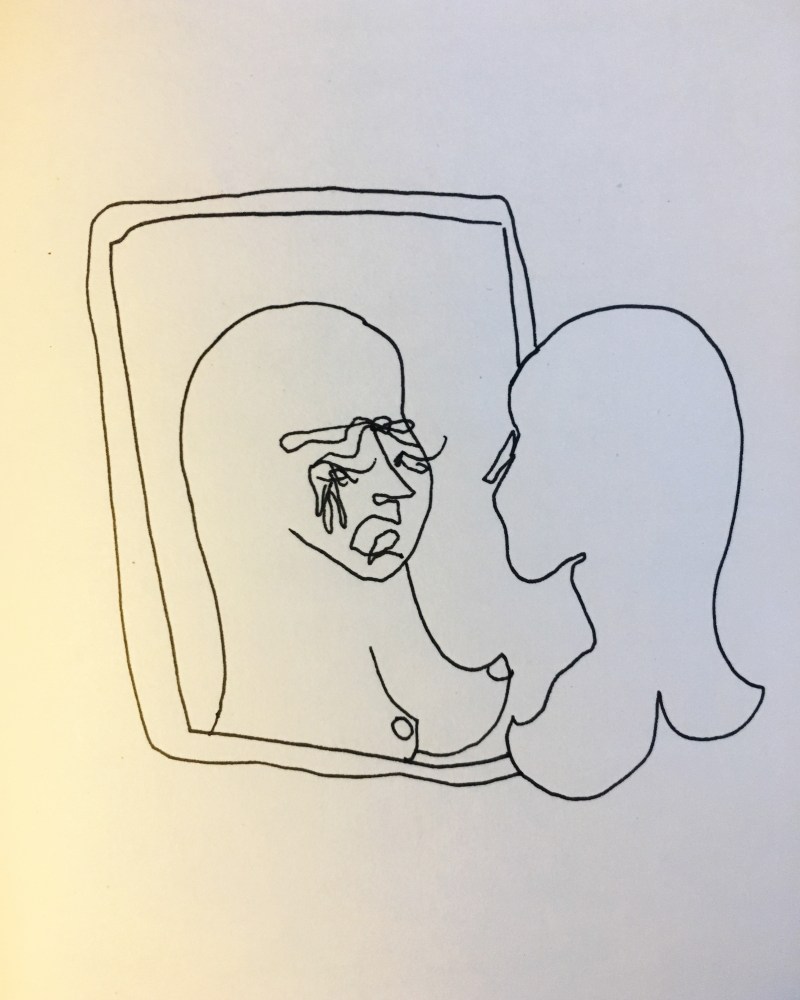
Ce mode d’être au monde par le sensible, très finement analysé par Camille Froidevaux-Metterie dans son article « La beauté féminine, un projet de coïncidence à soi« , prédispose les corps féminins à s’épancher sur leur apparence. Or le souci du paraître semble vulgaire, trivial ; ce legs maudit est voué à la dépréciation, ou pire, à l’avilissement. Pourtant, quand les hommes mettent main à la pâte, la mode, la fâcheuse, devient un grand art ; Yves Saint Laurent était un génie et Lagerfeld un artiste. Cela montre bien que la dévalorisation d’un héritage féminin n’est pas due à ce qu’il est (sa valeur), mais plutôt au genre à qui il s’adresse.
Cette culture féminine dont la mode fait partie est « embarrassante » (cf Mona Chollet, Beauté fatale). Les préoccupations esthétiques typiquement féminines sont dévaluées, elles ne valent même pas la peine d’en discuter. Les femmes héritent d’un capital culturel qui leur a été imposé certes, mais dont on se moque ou on s’amuse. La mode gêne tant qu’elle en est parvenue à diviser les femmes et surtout les féministes. Que faire en effet d’un héritage qui nous pousse à nous apprêter pour correspondre à l’injonction de plaire au regard désirant masculin ? Et qui, de surcroît, admet des idéaux de perfection tout à fait conjecturaux et pratiquement impossibles à atteindre ? Il y a de quoi en vouloir à la mode.
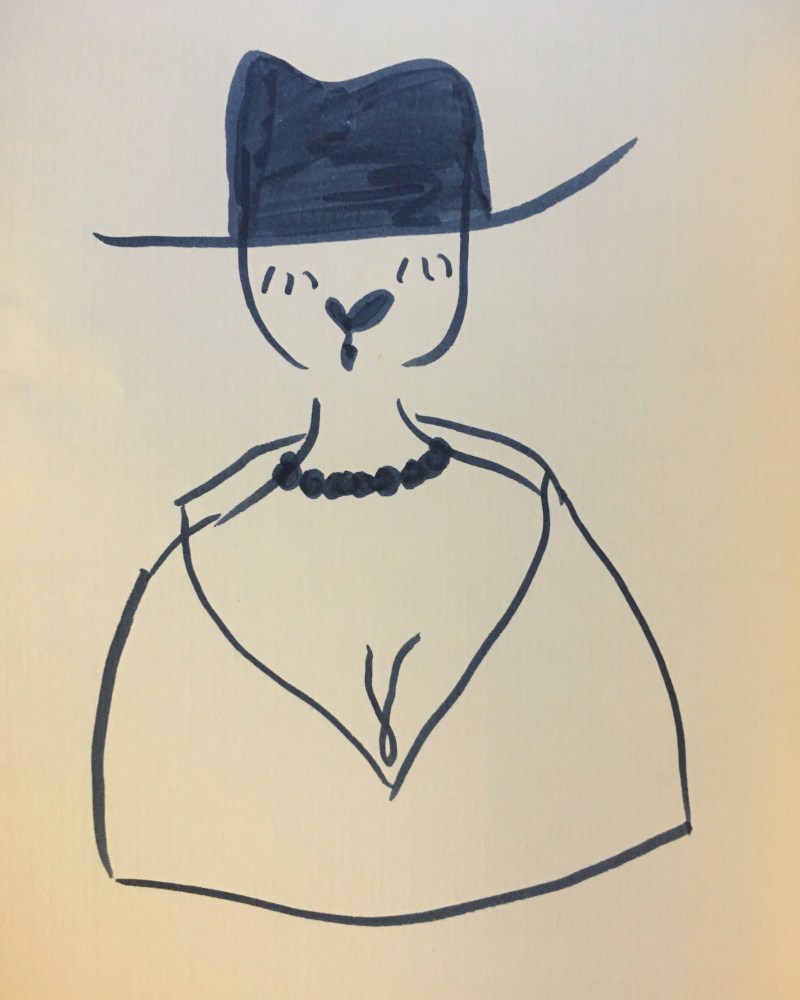
Pourtant, même si la tentation de dénigrer la mode peut être grande (et compréhensible), il ne faudrait pas vouloir s’en écarter pour entrer dans la sphère andocentrée de l’intellect. Cela répondrait au même mécanisme misogyne consistant à discréditer tout ce qui a trait à la féminité (dans le sens: intérêts et culture féminine, puisqu’une femme peut bien entendu être féminine sans s’apprêter). Au contraire, Camille Froidevaux-Metterie insiste : il est aussi importer de se ressaisir de ce legs, car raffiner sa propre forme est nécessaire pour coïncider à soi :
L’ornement relève donc autant de la gratuité que de la nécessité : il pourrait ne pas avoir lieu mais il répond aussi à un appel.
Le déni en bloc de l’apparence est une ruse pour consigner les femmes dans la honte et le silence, après les avoir diminuées à leur apparence sensible. Elles ne vivent qu’en tant que corps, et en plus elles doivent en ressentir une culpabilité certaine.
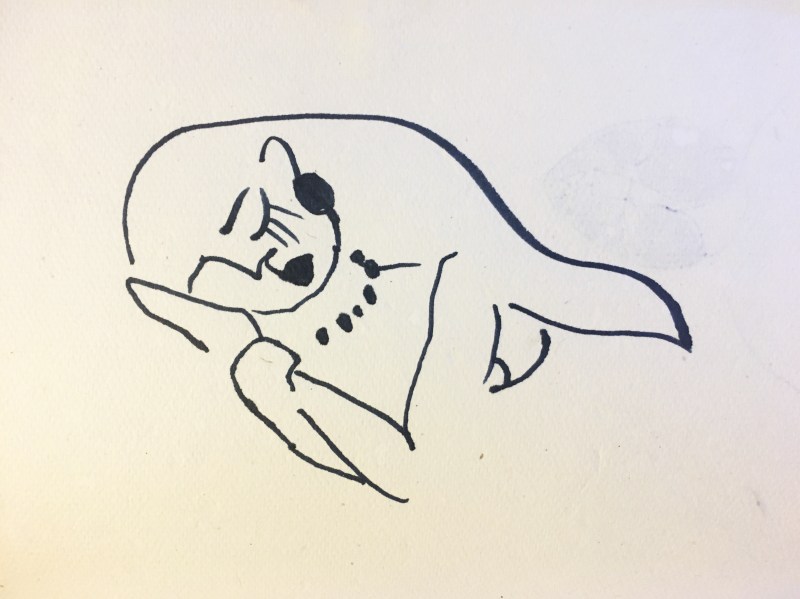
Parce qu’elle souligne tout ce qui nous agace, la mode est souvent tournée au ridicule ou prise à la légère. Pourtant elle est partout et elle véhicule un discours dont la matière est si dense qu’elle pourrait nous permettre de mieux nous comprendre : discours sur notre société, notre rapport au corps, au genre, sur notre éthique et nos conventions… bref, la mode souffre d’une réputation trop facile à lui céder – bien que cela aussi veuille dire quelque chose de cette industrie. Le tout est d’accepter que la surface puisse en dire plus que le fond, et que d’errer dans les tréfonds nauséabonds de la Caverne socratique ne nous permettra jamais de nous hisser par-delà les préjugés. Un peu de vernis ne fait jamais de mal à une peau trop usée, puante d’être restée campée sur ses certitudes trop longtemps. La profondeur n’est pas là où on croit.
Amélie Zimmermann


On a vite tendance à tourner en ridicule ce dont on voudrait se libérer… souvent, de la part de jeunes féministes, ça va avec un dénigrement global du « féminin » opposé aux femmes fortes, pas superficielles etc. On est beaucoup à être tombées là dedans à un moment ou l’autre et à en avoir pris conscience sur le tard
J’aimeJ’aime
Je suis complètement d’accord!
J’aimeAimé par 1 personne
J’avais déjà lu cet article, je viens de le relire, j’étais et je reste impressionnée par sa justesse, merci pour ces mots !
J’aimeJ’aime
Merci à toi, je suis très touchée !
J’aimeJ’aime